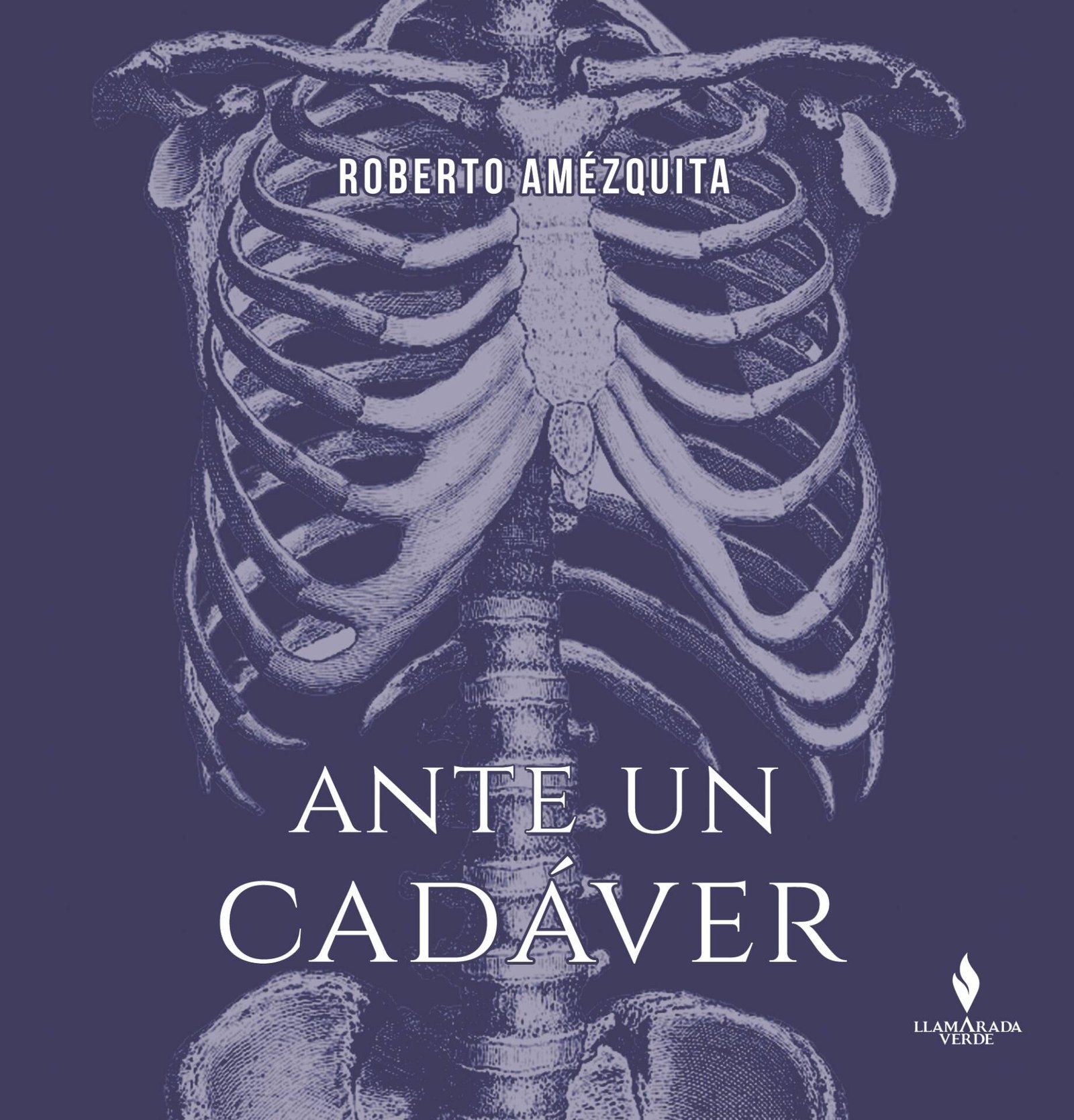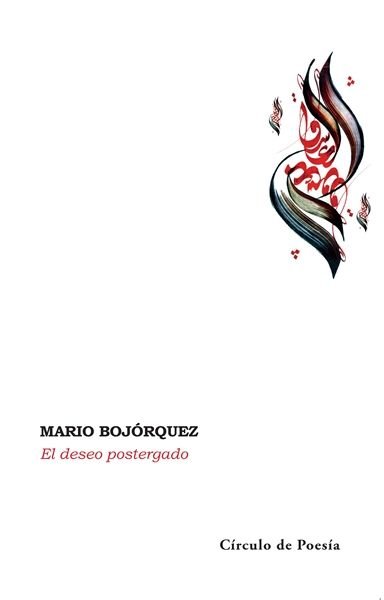Gustavo Osorio de Ita traduce “Génesis de un poema”, el texto con el cual Baudelaire presenta “El cuervo” de Edgar Allan Poe. El poeta francés había descubierto a Poe hacia 1847 y en 1853 tradujo “El cuervo”. “Génesis de un poema” es un ensayo con el que Baudelaire acompaña su traducción de The Phlosophy of Composition.
La Génesis de un Poema[1]
La poética se hace, se nos ha dicho, y se modela a partir de los poemas. He aquí un poeta que pretende referir que su poema fue compuesto a partir de su poética. Él poseía ciertamente un gran genio y tanto más de inspiración que cualquiera, si por inspiración se entiende la energía, el entusiasmo intelectual y la facultad de mantener sus facultades despiertas. Además, amaba también el trabajo más que cualquier otro; repetía constantemente, él, un original auténtico, que la originalidad es cosa de aprendizaje, lo que no quiere decir que resulte algo que pueda ser transmitido por la enseñanza. El azar y lo incomprensible fueron sus dos grandes enemigos. ¿Se volvió a sí mismo, por una vanidad extraña y sorprendente, mucho menos inspirado de lo que era por naturaleza? ¿Acaso disminuyó la gratuita facultad que yacía en él para conceder la más hermosa parte a la voluntad? Yo me inclinaría a creerlo así; aunque de cualquier forma resulte necesario no olvidar que su genio, si bien ardiente y ágil, se encontraba apasionadamente vinculado con el análisis, con las combinaciones y con el cálculo. Uno de sus axiomas favoritos era, después de todo, el siguiente: “Todo, tanto en un poema como en una novela, tanto en un soneto como en un cuento, debe converger en el desenlace. Un buen autor tiene ya su última línea prevista cuando escribe la primera”. Gracias a este admirable método, el compositor puede comenzar su obra por el final de la misma, y trabajar, cuando le plazca, en cualquiera de las partes de ésta. Los amantes del delirio tal vez se repugnen ante estas cínicas máximas; pero que cada quien las retome a su gusto. Será siempre útil mostrarles cuales son los beneficios que el arte puede obtener de la deliberación, y de hacer ver a la gente mundana cuánta y cuán ardua labor exige este objeto de lujo que hemos dado en llamar Poesía.
Después de todo, un poco de charlatanería siempre se le es permisible al genio, aunque no le siente del todo bien. Es, como los afeites sobre los pómulos de una mujer naturalmente bella, una sazón nueva para el espíritu.
Poema singular entre todos. Se desenvuelve a partir de una palabra misteriosa y profunda, terrible como el infinito, que millares de bocas crispadas han repetido desde el comienzo de las eras y que, por un trivial hábito de desesperación, más de un soñador ha escrito sobre la esquina de su mesa para probar su pluma: “¡Nunca más!” De esta idea, fecundada por la destrucción, es remplazada desde lo alto hasta el fondo, y la Humanidad, desperezada ya, acepta voluntariamente el Infierno, para escapar a la irremediable desesperanza contenida en esta palabra.
En el moldear hacia la prosa la poesía hay necesariamente una espantosa imperfección; pero el mal sería aún más grande si se buscara una tontería rimada. El lector comprenderá que me es imposible rendirle una idea exacta de la sonoridad profunda y lúgubre, de la poderosa monotonía de estos versos, donde las rimas largas y triplicadas suenan como un melancólico repique fúnebre. Es este el poema de el insomnio de la desesperanza; nada falta aquí: ni la fiebre de las ideas, ni la violencia de los colores, ni el razonamiento enfermo, ni el terror trémulo, ni tampoco esta bizarra alegría del dolor que lo vuelve aún más terrible. Escuchen cantar en su memoria las estrofas más lastimeras de Lamartine, los más magníficos y complicados ritmos de Víctor Hugo; mézclenlo con los tercetos más sutiles y comprehensivos de Théophile Gautier, –aquellos de Ténèbres, por ejemplo, ese rosario de formidables concetti[2] sobre la muerte y la nada, donde la rima triplicada se adapta perfectamente a la melancolía obsesiva–, y obtendrán quizás una idea aproximativa de los talentos de Poe en tanto versificador; yo digo “en tanto versificador”, puesto que resulta superfluo, pienso, hablar de su imaginación.
Pero escucho al lector que murmura como Alceste:
“Ya veremos”
PUES HE AQUÍ EL POEMA:
LE CORBEAU
« Une fois, sur le minuit lugubre, pendant que je méditais, faible et fatigué, sur maint précieux et curieux volume d’une doctrine oubliée, pendant que je donnais de la tête, presque assoupi, soudain il se fit un tapotement, comme de quelqu’un frappant doucement, frappant à la porte de ma chambre. « C’est quelque visiteur, — murmurai-je, — qui frappe à la porte de ma chambre ; ce n’est que cela, et rien de plus. »
Ah ! distinctement je me souviens que c’était dans le glacial décembre, et chaque tison brodait à son tour le plancher du reflet de son agonie. Ardemment je désirais le matin ; en vain m’étais-je efforcé de tirer de mes livres un sursis à ma tristesse, ma tristesse pour ma Lénore perdue, pour la précieuse et rayonnante fille que les anges nomment Lénore, — et qu’ici on ne nommera jamais plus.
Et le soyeux, triste et vague bruissement des rideaux pourprés me pénétrait, me remplissait de terreurs fantastiques, inconnues pour moi jusqu’à ce jour ; si bien qu’enfin, pour apaiser le battement de mon cœur, je me dressai, répétant : « C’est quelque visiteur qui sollicite l’entrée à la porte de ma chambre, quelque visiteur attardé sollicitant l’entrée à la porte de ma chambre ; — c’est cela même, et rien de plus. »
Mon âme en ce moment se sentit plus forte. N’hésitant donc pas plus longtemps : « Monsieur, — dis-je, — ou madame, en vérité j’implore votre pardon ; mais le fait est que je sommeillais, et vous êtes venu frapper si doucement, si faiblement vous êtes venu taper à la porte de ma chambre, qu’à peine étais-je certain de vous avoir entendu. » Et alors j’ouvris la porte toute grande ; — les ténèbres, et rien de plus !
Scrutant profondément ces ténèbres, je me tins longtemps plein d’étonnement, de crainte, de doute, rêvant des rêves qu’aucun mortel n’a jamais osé rêver ; mais le silence ne fut pas troublé, et l’immobilité ne donna aucun signe, et le seul mot proféré fut un nom chuchoté : « Lénore ! » — C’était moi qui le chuchotais, et un écho à son tour murmura ce mot : « Lénore ! » — Purement cela, et rien de plus.
Rentrant dans ma chambre, et sentant en moi toute mon âme incendiée, j’entendis bientôt un coup un peu plus fort que le premier. « Sûrement, — dis-je, — sûrement, il y a quelque chose aux jalousies de ma fenêtre ; voyons donc ce que c’est, et explorons ce mystère. Laissons mon cœur se calmer un instant, et explorons ce mystère ; — c’est le vent, et rien de plus. »
Je poussai alors le volet, et, avec un tumultueux battement d’ailes, entra un majestueux corbeau digne des anciens jours. Il ne fit pas la moindre révérence, il ne s’arrêta pas, il n’hésita pas une minute ; mais, avec la mine d’un lord ou d’une lady, il se percha au-dessus de la porte de ma chambre ; il se percha sur un buste de Pallas juste au-dessus de la porte de ma chambre ; — il se percha, s’installa, et rien de plus.
Alors cet oiseau d’ébène, par la gravité de son maintien et la sévérité de sa physionomie, induisant ma triste imagination à sourire : « Bien que ta tête, — lui dis-je, — soit sans huppe et sans cimier, tu n’es certes pas un poltron, lugubre et ancien corbeau, voyageur parti des rivages de la nuit. Dis-moi quel est ton nom seigneurial aux rivages de la Nuit plutonienne ! » Le corbeau dit : « Jamais plus ! »
Je fus émerveillé que ce disgracieux volatile entendît si facilement la parole, bien que sa réponse n’eût pas un bien grand sens et ne me fût pas d’un grand secours ; car nous devons convenir que jamais il ne fut donné à un homme vivant de voir un oiseau au-dessus de la porte de sa chambre, un oiseau ou une bête sur un buste sculpté au-dessus de la porte de sa chambre, se nommant d’un nom tel que Jamais plus !
Mais le corbeau, perché solitairement sur le buste placide, ne proféra que ce mot unique, comme si dans ce mot unique il répandait toute son âme. Il ne prononça rien de plus ; il ne remua pas une plume, — jusqu’à ce que je me prisse à murmurer faiblement : « D’autres amis se sont déjà envolés loin de moi ; vers le matin, lui aussi, il me quittera comme mes anciennes espérances déjà envolées. » L’oiseau dit alors : « Jamais plus ! »
Tressaillant au bruit de cette réponse jetée avec tant d’à-propos : « Sans doute, — dis-je, — ce qu’il prononce est tout son bagage de savoir, qu’il a pris chez quelque maître infortuné que le Malheur impitoyable a poursuivi ardemment, sans répit, jusqu’à ce que ses chansons n’eussent plus qu’un seul refrain, jusqu’à ce que le De profundis de son Espérance eût pris ce mélancolique refrain : Jamais, jamais plus !
Mais, le corbeau induisant encore toute ma triste âme à sourire, je roulai tout de suite un siège à coussins en face de l’oiseau et du buste et de la porte ; alors, m’enfonçant dans le velours, je m’appliquai à enchaîner les idées aux idées, cherchant ce que cet augural oiseau des anciens jours, ce que ce triste, disgracieux, sinistre, maigre et augural oiseau des anciens jours voulait faire entendre en croassant son Jamais plus !
Je me tenais ainsi, rêvant, conjecturant, mais n’adressant plus une syllabe à l’oiseau, dont les yeux ardents me brûlaient maintenant jusqu’au fond du cœur ; je cherchais à deviner cela, et plus encore, ma tête reposant à l’aise sur le velours du coussin que caressait la lumière de la lampe, ce velours violet caressé par la lumière de la lampe que sa tête, à Elle, ne pressera plus, — ah ! jamais plus !
Alors il me sembla que l’air s’épaississait, parfumé par un encensoir invisible que balançaient des séraphins dont les pas frôlaient le tapis de la chambre. « Infortuné ! — m’écriai-je, — ton Dieu t’a donné par ses anges, il t’a envoyé du répit, du répit et du népenthès dans tes ressouvenirs de Lénore ! Bois, oh ! bois ce bon népenthès, et oublie cette Lénore perdue ! » Le corbeau dit : « Jamais plus ! »
« Prophète ! — dis-je, — être de malheur ! oiseau ou démon, mais toujours prophète ! que tu sois un envoyé du Tentateur, ou que la tempête t’ait simplement échoué, naufragé, mais encore intrépide, sur cette terre déserte, ensorcelée, dans ce logis par l’Horreur hanté, — dis-moi sincèrement, je t’en supplie, existe-t-il, existe-t-il ici un baume de Judée ? Dis, dis, je t’en supplie ! » Le corbeau dit : « Jamais plus ! »
« Prophète ! — dis-je, — être de malheur ! oiseau ou démon ! toujours prophète ! par ce Ciel tendu sur nos têtes, par ce Dieu que tous deux nous adorons, dis à cette âme chargée de douleur si, dans le Paradis lointain, elle pourra embrasser une fille sainte que les anges nomment Lénore, embrasser une précieuse et rayonnante fille que les anges nomment Lénore. » Le corbeau dit : « Jamais plus ! »
« Que cette parole soit le signal de notre séparation, oiseau ou démon ! — hurlai-je en me redressant. — Rentre dans la tempête, retourne au rivage de la Nuit plutonienne ; ne laisse pas ici une seule plume noire comme souvenir du mensonge que ton âme a proféré ; laisse ma solitude inviolée ; quitte ce buste au-dessus de ma porte ; arrache ton bec de mon cœur et précipite ton spectre loin de ma porte ! » Le corbeau dit : « Jamais plus ! »
Et le corbeau, immuable, est toujours installé, toujours installé sur le buste pâle de Pallas, juste au-dessus de la porte de ma chambre ; et ses yeux ont toute la semblance des yeux d’un démon qui rêve ; et la lumière de la lampe, en ruisselant sur lui, projette son ombre sur le plancher ; et mon âme, hors du cercle de cette ombre qui gît flottante sur le plancher, ne pourra plus s’élever, — jamais plus !
La traducción de “El Cuervo” fue publicada por Richard Lesclide en 1875 con las ilustraciones de Edourad Manet que aquí se incluye:
[1] Este texto es la presentación de Charles Baudelaire a su propia traducción del poema “El Cuervo”, publicado en 1845 por Edgar Allan Poe en el New York Evening Mirror. La traducción y el texto aquí traducido al español apareció por vez primera en 1859 en la Revue Française (Nota del traductor, de aquí en adelante “N. del T.”).
[2] En el original en italiano, que se traduce por “conceptos” (N. del T.)